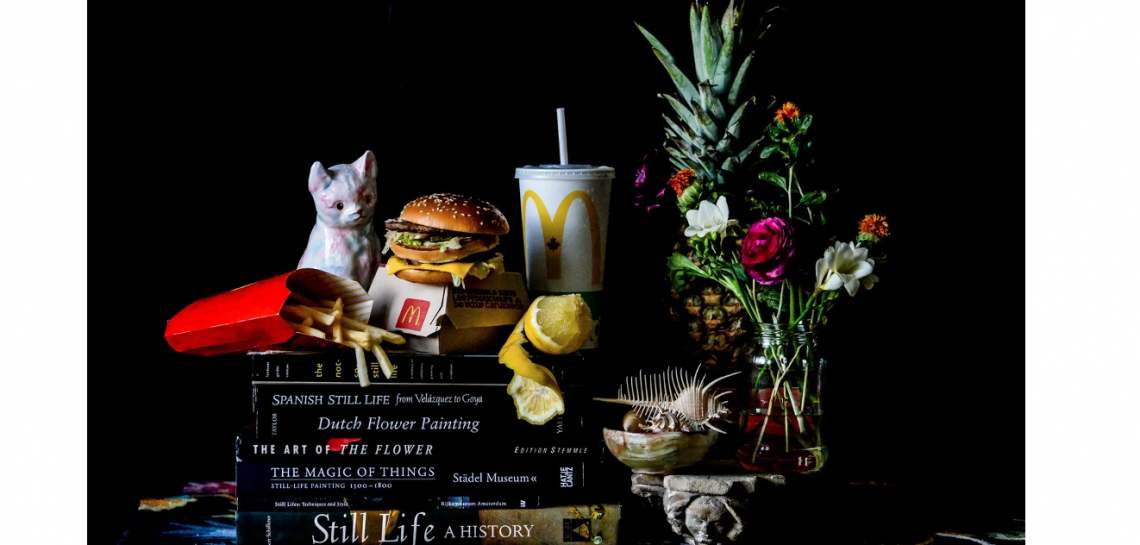L'individu et le collectif : une équation à repenser, pas à opposer
Le 3 octobre dernier, le colloque d'automne de l'ABCI posait la question suivante : dans un monde où tout se personnalise, du pot de Nutella à l'algorithme qui filtre nos idées, peut-on encore faire culture commune en entreprise ? Et surtout : le faut-il ?
La réponse est sans équivoque. Oui, il le faut. Mais pas n'importe comment. Ce que révèle cette journée de débats, de données et de diagnostics croisés, c'est que l'opposition entre individu et collectif est un faux procès. Le vrai enjeu ? Repenser leur articulation. Car sans collectif, l'individu s'épuise dans le vide. Et sans individu reconnu, le collectif sombre dans l'abstraction stérile.
L'hyper-individualisation : un dissolvant du lien ?
Denis Pennel, expert des mutations du travail, plante le décor. Le travail a basculé : de l'obligation au devoir, il est devenu quête d'accomplissement, voire exigence de bien-être. En soi, rien de condamnable. Sauf que cette évolution s'est accompagnée d'une fragmentation sans précédent des conditions de travail.
Horaires flexibles, télétravail à la carte, rémunération personnalisée, parcours de carrière individualisés : l'entreprise a désagrégé l'expérience collective au nom de l'adaptation à chacun. Cette flexibilité, initialement censée libérer, est devenue un dissolvant du lien. La rencontre se raréfie. La concurrence interne s'installe. Et les tensions psychologiques explosent. 42 % des Belges se déclarent en surcharge de travail. Chiffre éloquent d'une individualisation mal pilotée.
L'individualisation n'est pas le problème en soi. Ajuster les statuts, les conditions, les packages, soit. Mais cela ne répond pas à l'enjeu profond : l'individuation, ce processus par lequel le sujet construit du sens. Et c'est précisément là que le communicant interne doit intervenir.
Le collectif comme matrice de l'individu
L'équation proposée par Denis Pennel est limpide : sans esprit collectif, pas de chemin individuel possible. L'engagement naît d'une triple dynamique : satisfaction (la base), motivation (l'énergie), engagement (le surplus d'implication). Ce dernier n'est pas un don spontané. Il résulte d'un processus où le sens (dans ses trois significations : direction, signification, sensation) occupe une place cardinale.
Le manager intermédiaire devient alors la figure pivot. Il doit naviguer entre trois casquettes : commander (donner le cadre), coacher (développer son équipe), et inspirer (donner le cap, la vision). Une duplicité nécessaire, entre bienveillance et exigence. Car le lien ne se nourrit ni de gentillesse molle ni d'autorité brutale. Il se construit dans la juste tension qui protège et fait grandir.
Quatre leviers concrets émergent :
1. Repenser l'espace. Le bureau doit cesser d'être une juxtaposition de postes pour devenir un catalyseur de rencontres. Espaces flexibles, adaptés à la collaboration, à la co-création, aux échanges informels. Idéalement, un lieu meilleur qu'à la maison.
2. Ressusciter les rituels. Célébrer les succès, marquer les anniversaires, développer des projets porteurs de sens liés notamment à la RSE. Le rite réaffirme l'existence et la valeur du groupe. Il ancre le symbolique dans le quotidien.
3. Structurer la parole. Créer des mécanismes d'écoute (audits, groupes de parole), des comités consultatifs pour que chacun se sente entendu et puisse influencer. Le sentiment d'appartenance passe par le sentiment d'être pris en compte.
4. Accompagner l’expérience employé. Faire de l'onboarding et de l'offboarding des moments qui soulignent l'intégration, le feed-back et la reconnaissance. Mobiliser les managers intermédiaires comme porteurs de cette nouvelle culture du lien.
Le communicant : porte-voix, pas porte-parole
Patrice de La Broise, professeur en sciences de l'information et de la communication, affûte le diagnostic. Le rôle du communicant interne se redéfinit. Il n'est plus le simple relais de la direction. Il devient garant d'un cadre éthique et culturel robuste.
Privilégier l'acculturation à la prescription. La culture se construit par l'expérience, dans le temps long, par un processus d'intégration partagée des valeurs. La prescription culturelle (injonction top-down) échoue systématiquement.
Arbitrer entre pertinence et transparence. Tout ne peut pas être dit, tout le temps, à tout le monde. La transparence totale est une illusion paralysante. Ce qui compte : ce qui doit absolument être dit et compris pour maintenir le cap. Le partage raisonné prime sur l'inflation informationnelle.
Dépasser l'interactivité pour viser l'interaction. L'interaction véritable suppose confrontation d'idées, co-construction, mise en débat. Les rituels polyphoniques, ces espaces où la parole circule collectivement, sont indispensables. Osons la métaphore de l'orchestre : il faut éviter la cacophonie et travailler harmonieusement à un objectif commun qui nous dépasse.
Activer les salariés-sujets. Les positionner en acteurs des transformations, leur donner les moyens de répondre aux enjeux sociétaux de l'entreprise. Encourager chaque collaborateur à sentir qu'il contribue à écrire l'histoire de l'entreprise, liant sa quête de sens à l'épopée collective.
Ce que révèle le Moodmeter : le contenu avant le canal
Katja Werbrouck, co-fondatrice de Moodfactory, apporte les données qui clarifient le débat. Le Moodmeter 2025, construit sur l'avis de plus de 1 000 employés belges, est implacable : 53 % des employés estiment que la communication reçue n'est pas pertinente ou utile pour leur rôle.
Ce n'est pas un problème de canal. C'est un problème de contenu. Cinq facteurs expliquent cet écart béant entre l'offre de communication et sa perception :
1. Transparence. Un répondant sur deux déplore son absence. Sans clarté, pas de confiance.
2. Accessibilité. L'information doit être facile à trouver et à consulter. Le but est de rendre l'employé plus efficace, non de lui faire perdre son temps.
3. Timing. 45 % jugent que l'information n'arrive pas au bon moment. Une communication décalée est une communication inutile.
4. Résonance. La communication doit répondre à la réalité des employés. Toute déconnexion entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils lisent crée un effet de rejet.
5. Reconnaissance dans le collectif. Les outils doivent être des miroirs, pas des vitrines. Les employés doivent se reconnaître dans ce qui leur est communiqué.
Le manager occupe ici un rôle central. Il est créateur d'information locale, celle qui concerne l'équipe et le lieu de travail, information extrêmement valorisée par les collaborateurs. Il faut d’ailleurs prévoir du temps structurel pour la communication managériale.
Les enjeux 2025-2026 : un nuage de mots révélateur
Les participants au colloque ont été invités à formuler leurs principaux enjeux de communication interne pour les deux années à venir. Le nuage de mots obtenu est parlant : transformation culturelle, reconnaissance, engagement, soutenir les managers, sentiment d'appartenance, conduire le changement, valoriser, rassembler. Ce qui émerge, c'est une demande de sens, de lien, de cadre. Une demande d'humanité organisée.
Les questions à se poser
Le colloque a été l’occasion de se poser collectivement une série de questions aussi simples qu'exigeantes, adressées aux communicants internes :
- Où se place le bien-être de vos collaborateurs dans vos priorités de communication interne ?
- Quelle est votre contribution à l'engagement de vos collaborateurs ?
- Comment accompagnez-vous vos managers intermédiaires face aux attentes des collaborateurs ?
- Êtes-vous associé aux processus de recrutement et de fidélisation définis par la Direction des Ressources Humaines ?
- Comment pouvez-vous recréer du collectif au travail sans nier l'individu ?
Ces questions n'appellent pas de réponses rapides. Elles imposent un travail réflexif, une remise en question des pratiques installées, un courage managérial renouvelé.
Pistes d'action : de la réflexion à l'opérationnel
Que faire, concrètement ? Plusieurs pistes émergent, synthèse des trois interventions et du débat :
Réinsuffler du temps long. Résister à l'immédiateté. Créer des espaces de réflexion profonde. Instaurer un suivi de la communication sur certains sujets centraux et donner à voir qu'on écoute les attentes des salariés. Une approche de type « feuilleton » sur des sujets choisis par les collaborateurs peut être efficace.
Partir du vécu utilisateur. Ne plus conceptualiser pour traduire, mais partir du terrain pour conceptualiser. Les meilleurs projets de communication naissent de l'expérience réelle, non d'abstractions plaquées.
Communiquer sur ce qui fait l'unicité de l'entreprise. Histoire, vision, valeurs, produits et services, stratégie. Mettre en avant des objectifs et projets communs. Encourager la collaboration et la co-création.
Affronter le travail réel. Pas ce qui entoure le travail. Le cœur opérationnel doit être au centre des préoccupations de communication.
Actionner les différents leviers de motivation. Comprendre que chaque individu n'est pas mû par les mêmes ressorts. Adapter sans segmenter à outrance.
Adopter le leadership par les pieds. On ne gagne la confiance, le respect et l'engagement qu'en passant du temps auprès de ceux qui font, dans les interstices de ces relations sur le terrain.
Favoriser l'interaction, pas seulement l'interactivité. L'IA peut être une assistance pour s'assurer de la pertinence du message, mais ne peut se substituer à l'échange humain.
Passer de l'entreprise libérée à l'entreprise délibérée. Écouter pour pouvoir agir. Créer des espaces de délibération collective, des rituels polyphoniques où la parole circule.
Conclusion : le lien comme nouveau capital
L'individu et le collectif ne sont pas en guerre. Ils sont en tension nécessaire. L'enjeu pour le communicant interne n'est pas de choisir son camp, mais de tenir l'équilibre. De garantir que l'organisation reste un lieu où le sujet peut émerger sans détruire le collectif. Où l'autonomie ne se paie pas en atomisation. Où la reconnaissance individuelle ne se fait pas au détriment de la culture commune.
Le lien est le nouveau capital. Il se construit, se cultive, s'entretient. Dans le temps long, par des rituels, des espaces de parole, des récits partagés. Par une communication qui choisit la pertinence sur la transparence totale, l'interaction sur l'interactivité, l'acculturation sur la prescription.
Car sans esprit collectif, il n'y aura de possibilité de chemin individuel pour personne. C'est peut-être la plus belle définition de la mission du communicant interne : marginal sécant, gardien du sens, activateur de la conversation qui fait société.
@Crédit Photos : Olivier Pirard