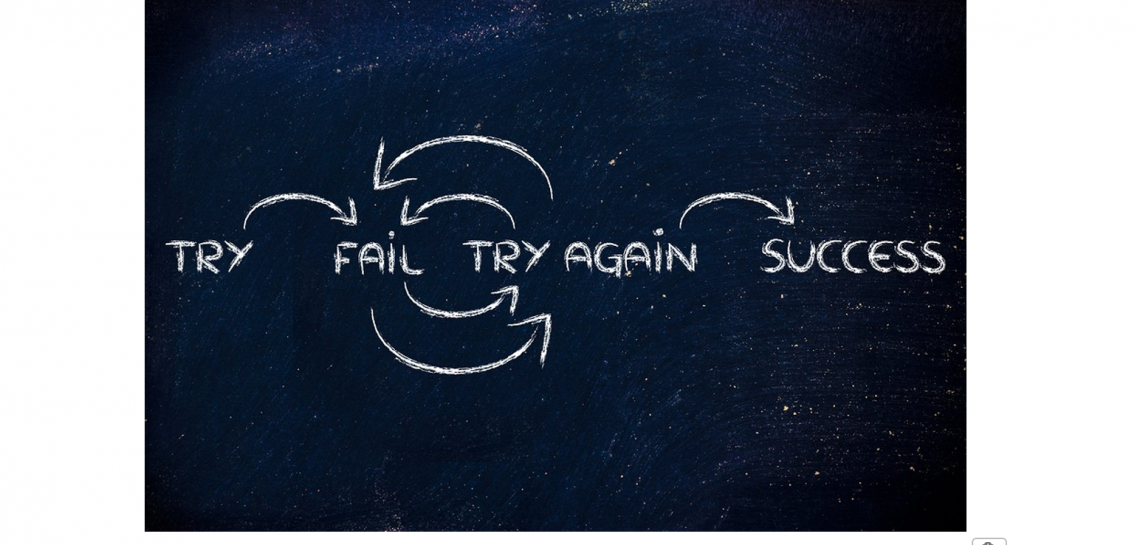
Etes-vous un designer d'expérience qui s'ignore ?
À l'ère de la surcharge cognitive et de la complexité organisationnelle, le modèle traditionnel de la communication interne, descendant et centré sur le message, on le sait, est devenu obsolète. Le flot continu d'informations, diffusé en cascade depuis le sommet, se heurte à un mur d'indifférence et d'épuisement. L'antidote à cette communication descendantce réside notamment dans le fait d'opérer comme un designer d'expérience. Quand on parle de “design”, il ne s'agit pas ici d'une question d'esthétique ou de "jolies présentations", mais de l'application rigoureuse des principes du design centré sur l'humain pour façonner la manière dont les collaborateurs vivent et perçoivent leur organisation. Chaque e-mail, chaque outil, chaque réunion est une facette de cette expérience. Il est donc temps de les concevoir avec intention.
Le "User" : anatomie cognitive du collaborateur
Tout processus de design commence par une compréhension profonde et empathique de l'utilisateur final. En communication interne, cet "utilisateur" est le collaborateur, un acteur dont les réalités cognitives et motivationnelles sont trop souvent ignorées par les stratégies conventionnelles. Plutôt que de s'appuyer sur des organigrammes et des hypothèses, une approche design exige de déconstruire le modèle de l'employé-récepteur pour le remplacer par un portrait plus juste, éclairé par les sciences cognitives.
Le mythe du récepteur rationnel
Le modèle de la "cascade" d'information repose sur une croyance erronée : celle que les collaborateurs sont des récepteurs passifs et rationnels, attendant patiemment d'absorber les messages de l'entreprise. La réalité de notre fonctionnement cérébral est tout autre. L'esprit humain n'est pas une page blanche ; il est sélectif, distrait et suit ses propres règles.
- L'esprit humain est un nomade qui vagabonde environ 30 % du temps. Des recherches en psychologie cognitive le confirment : pendant qu'un manager présente les résultats trimestriels, une part significative de son auditoire pense à sa liste de courses, à ses prochaines vacances ou à une conversation de la veille (désolée de briser des rêves)
- L'attention soutenue est une ressource limitée qui dure environ dix minutes. Au-delà de ce seuil, elle décline de manière significative. Ce format est fondamentalement incompatible avec des artefacts comme la réunion traditionnelle d'une heure ou la présentation des résultats trimestriels de 30 minutes, qui demandent un effort cognitif que peu de cerveaux sont capables de maintenir.
- Notre attention est sélective et automatique. Notre cerveau a évolué pour prioriser certaines informations. Il est irrésistiblement attiré par des signaux spécifiques comme le danger, la nourriture, le mouvement, les visages et les histoires, bien plus que par les annonces corporate abstraites.
Cette incompatibilité fondamentale entre les tendances naturelles du cerveau et le modèle de diffusion traditionnel explique pourquoi tant de communications échouent. Elles ne sont pas conçues pour le cerveau qui les reçoit.
L'interface cérébrale : penser pour le cerveau qui reçoit
Pousser de l'information dense sans se soucier de la charge cognitive qu'elle impose à son destinataire est l'équivalent de concevoir un logiciel sans tenir compte de la mémoire vive de l'ordinateur. Le communicant designer, au contraire, doit concevoir ses messages en respectant les contraintes de l'interface cérébrale.
- La mémoire à court terme est un goulot d'étranglement. Les individus ne peuvent retenir simultanément qu'environ quatre éléments nouveaux. Ce goulot d'étranglement cognitif est la raison pour laquelle le typique e-mail ou la diapositive PowerPoint des "10 piliers stratégiques du CEO" sont voués à l'échec ; au cinquième pilier, le premier a déjà été oublié.
- Reconnaître est plus facile que se souvenir. La reconnaissance (identifier une information déjà vue) est un processus cognitif beaucoup moins coûteux que le rappel (récupérer une information de sa mémoire sans indice). Cette distinction a des implications majeures pour la conception des intranets ou des supports de présentation. L'information doit être structurée pour être facilement retrouvée et reconnue, plutôt que de forcer le collaborateur à se souvenir d'où elle se trouve.
- Le "chunking" est un principe de conception fondamental. Le cerveau traite plus efficacement l'information lorsqu'elle est présentée en petits blocs cohérents ("chunks"). Structurer une communication en sections courtes et distinctes, avec des titres clairs, facilite considérablement son absorption et sa mémorisation.
Le défi principal du communicateur n'est donc pas de faire sortir le message, mais de le concevoir pour qu'il puisse entrer et être traité par un cerveau aux capacités limitées.
Comprendre les limites cognitives de l'utilisateur est la première étape ; la suivante consiste à repenser radicalement le processus par lequel nous cherchons à l'engager.
Le process : de la campagne au prototype
Si les collaborateurs sont des utilisateurs, nos méthodes pour interagir avec eux doivent être plus sophistiquées que le modèle linéaire de la "campagne de communication". Lancer une initiative en "big bang" et espérer qu'elle fonctionne est une approche risquée et souvent inefficace. Le design thinking propose un cadre alternatif intéressant : un processus itératif, expérimental et profondément centré sur l'humain, qui déplace l'attention des livrables parfaits vers les résultats effectifs.
L'empathie avant la stratégie
La pierre angulaire du processus de design est l'empathie. Dans le contexte du design, l'empathie est l'effort délibéré de voir le monde à travers les yeux des collaborateurs. Son but n'est pas de générer une connaissance abstraite, mais de traduire ces observations en aperçus concrets qui permettront de concevoir des interventions (des processus, des outils, des communications) qui améliorent réellement leur quotidien. Cette approche est l'antidote nécessaire aux méthodes traditionnelles comme les sondages d'engagement. Un sondage capture des opinions sur l'expérience tandis que l'observation empathique capture l'expérience elle-même. Elle révéle les frictions tacites et les besoins non articulés que les données quantitatives ne peuvent jamais découvrir.
L'exemple de Kristian Simsarian, chercheur chez IDEO, est à ce titre éclairant. Pour comprendre l'expérience patient dans un service d'urgences, en simulant une blessure au pied, il s'est fait admettre comme un patient ordinaire, vivant personnellement la désorientation du processus d'admission, la frustration de l'attente et l'anxiété des couloirs anonymes. Cette immersion lui a fourni des aperçus qu'aucun sondage n'aurait pu révéler. Pour le communicant, cela signifie sortir de son bureau, observer les rituels d'une réunion d'équipe, ou suivre un collaborateur sur le terrain pour découvrir les véritables obstacles à la compréhension et à l'engagement.
L'art de prototyper : échouer tôt pour réussir mieux
Le design thinking embrasse le principe de "échouer tôt, échouer souvent" comme une méthode pour dé-risquer l'innovation et accélérer l'apprentissage. Plutôt que de passer des mois à perfectionner une initiative pour la déployer à grande échelle, le prototypage consiste à créer rapidement des versions quick and dirty, basse-fidélité et testables. Les designers parlent de prototypes « à basse fidélité », qui sont juste assez aboutis pour être partagés avec les personnes dont l’avis importe. Cela permet de commettre des erreurs plus rapidement (pour les corriger plus vite), en identifiant les aspects à améliorer tout en validant ce qui fonctionne déjà efficacement.
En communication interne, un prototype n'est pas un produit physique. Il peut prendre la forme de :
- Un nouveau format d'e-mail testé sur un petit groupe pilote, parce que le coût de l'échec est quasi nul et l'apprentissage sur la clarté et l'engagement est immédiat.
- Une maquette d'alerte sur GSM pour les communications urgentes, afin de tester la pertinence et la tonalité avant de développer l'outil.
- Un pilote pour une nouvelle structure de réunion, permettant de tester l'impact sur la prise de décision et la perte de temps avant de perturber toute l'organisation.
- Un scénario dessiné (storyboard) illustrant une nouvelle procédure, pour s'assurer que les étapes sont comprises par tous avant de rédiger une documentation complexe.
Cette approche transforme le rôle du communicateur. Il n'est plus un producteur de contenu focalisé sur la perfection du livrable final, mais un designer d'expérience qui teste, apprend et itère pour maximiser l'efficacité de ses interventions.
Adopter un processus de design itératif crée le besoin d'outils spécifiques permettant de visualiser et d'orchestrer les expériences complexes que nous cherchons à améliorer.
Les outils : cartographier l'invisible
Pour concevoir efficacement une expérience, il faut d'abord être capable de la voir dans sa totalité. L'organigramme traditionnel est aveugle aux parcours réels, aux émotions et aux interactions qui constituent la vie de l'entreprise. Des outils de visualisation issus du service design permettent de cartographier ces parcours humains, ce qui permet de révéler les connexions systémiques qui restent invisibles sur un schéma hiérarchique.
La "employee journey map"
L'expérience collaborateur n'est pas une collection de moments isolés, mais un parcours continu avec des étapes et des points de contact distincts. Ce voyage commence bien avant le premier jour, lors de la phase d'attraction, et se poursuit à travers le recrutement, l'intégration, la vie dans l'entreprise, jusqu'au départ du collaborateur.
La cartographie de ce parcours (employee journey map) permet d'identifier les moments critiques (touchpoints) et les points de friction (pain points). C'est à ces moments charnières que la communication peut soit échouer de manière catastrophique (un silence radio durant les semaines précédant l'arrivée d'un nouveau), soit créer une valeur immense (un processus d'intégration clair et rassurant). Cet outil déplace l'attention des messages isolés vers une vision holistique et séquentielle de l'expérience vécue.
Le "Service Blueprint" : relier le visible à l'invisible
Le Service Blueprint (ou schéma de service) est un outil systémique également intéressant. Il va au-delà du parcours de l'employé pour cartographier les mécanismes organisationnels qui le soutiennent. Il distingue deux niveaux fondamentaux :
- Le "Frontstage" : toutes les actions, personnes et artefacts qui sont visibles pour le collaborateur (ex: l'e-mail de bienvenue, l'interface de l'intranet, l'entretien annuel avec son manager).
- Le "Backstage" : tous les processus internes, systèmes et actions des autres employés qui sont invisibles pour le collaborateur mais indispensables au bon déroulement de l'expérience (ex: le processus RH de création du contrat, le système informatique qui gère les accès, la coordination entre départements pour préparer l'arrivée d'un nouveau).
En reliant explicitement ces deux couches, le blueprint permet au communicant de diagnostiquer les causes profondes d'un problème d'expérience. Une communication confuse (symptôme visible en frontstage) peut provenir d'un processus interne défaillant ou d'un manque de coordination en backstage. Cet outil apporte une réelle plus value à la démarche du communicateur. Au lieu de simplement rapporter un problème de communication ("Les gens sont confus par l'e-mail sur la nouvelle politique de dépenses"), il présente un diagnostic systémique étayé ("La communication est confuse car le processus backstage impliquant la Finance et l'IT est défaillant à ce point de contact précis"). Le communicateur n'est alors plus un simple clarificateur de messages, mais un partenaire stratégique qui facilite l'amélioration organisationnelle systémique.
Ce rôle de designer n'est pas un simple ajout de tâches, mais une redéfinition fondamentale de la finalité et de la valeur stratégique de la fonction. Il s'agit de passer de la gestion de messages à la création des conditions favorables à la compréhension, à l'engagement et à la performance. Chaque communication, qu'il s'agisse d'une note de service ou d'un événement d'entreprise, est une intervention dans le système organisationnel. Il est temps de concevoir ces interventions avec la rigueur, l'empathie et l'intention stratégique qu'elles méritent.
Pour aller plus loin
Voici une sélection de ressources pour approfondir ces sujets :
• Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation par Tim Brown
• Designing for Growth: A Design Thinking ToolKit for Managers par Jeanne Liedtka et Tim Ogilvie
• Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All par Tom Kelley et David Kelley
• The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent... par Jacob Morgan
• The Employee Experience: How to Attract Talent, Retain Top Performers, and Drive Results par Tracy Maylett et Matthew Wride.
• Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead par Laszlo Bock.
• Rapport McKinsey & Company (2021) : This time it’s personal: Shaping the ‘new possible’ through employee experience
• Drive: The Surprising Truth about What Motivates Us par Daniel H. Pink
• Flow: The Psychology of Optimal Experience par Mihaly Csikszentmihalyi
• The Best Place to Work: The Art and Science of Creating an Extraordinary Workplace par Ron Friedman
• Don’t Make Me Think! par Steve Krug
• Article MIT Sloan Review : "Design Work to Prevent Burnout" par Sharon K. Parker et Caroline Knight
• This is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World par Marc Stickdorn et al. en
• Les ressources pour le Design Centré sur l'Humain d'IDEO et d.school : mes trousses d'outils (toolkits) comme Human-Centered Design Toolkit et Design Thinking for Educators



